L’EDIA à l’UQAR
Avec ses efforts pour l’équité, la diversité, l’inclusion et l’accessibilité (EDIA), l’Université souhaite mettre en place des actions à court, moyen et long termes pour offrir un milieu de travail et d’études inspirant et qui ne laisse personne de côté et sait valoriser tous ses talents.
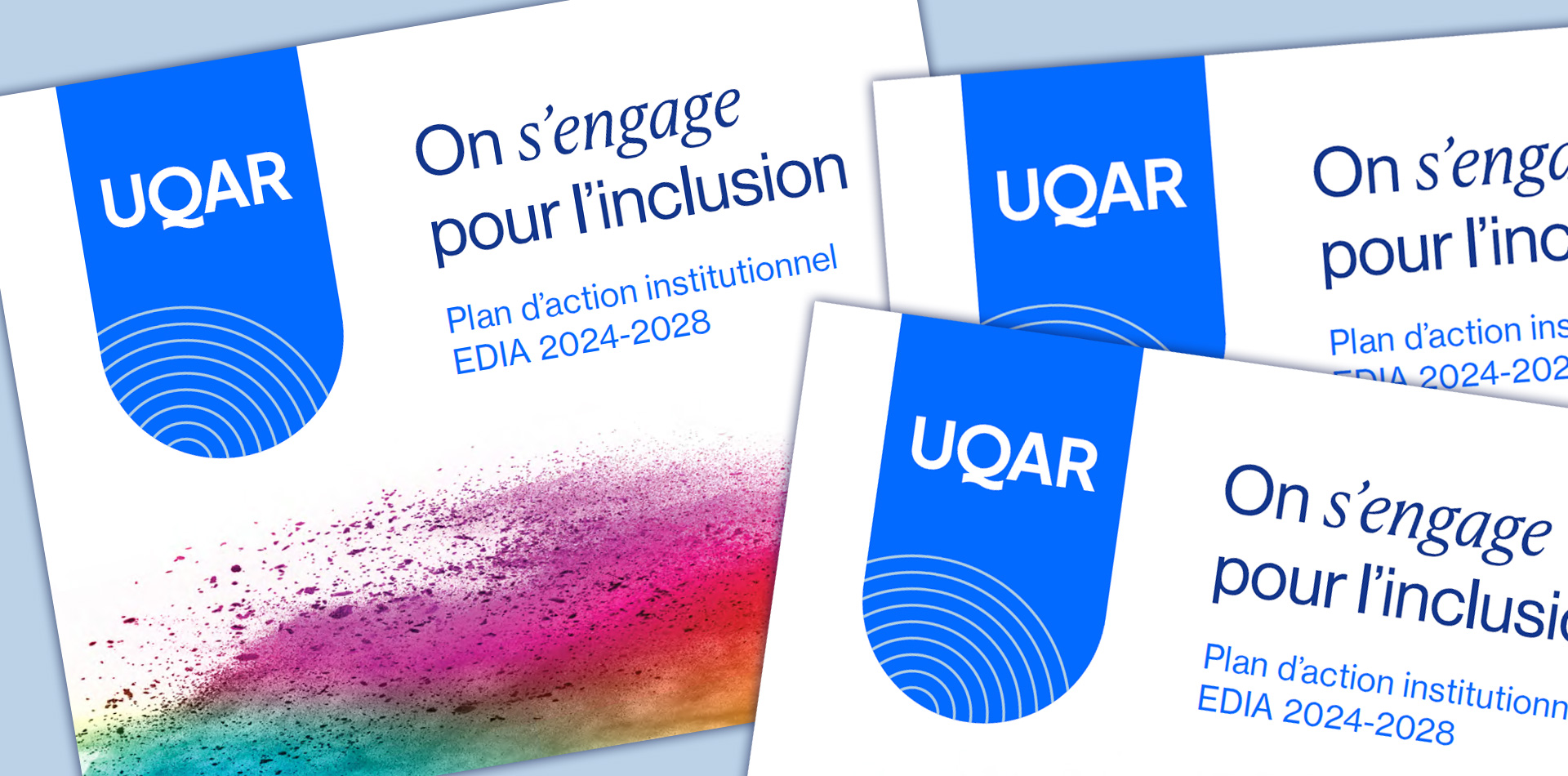
Structure ÉDI
L’EDIA enrichit notre communauté, et s’adresse à tout le monde puisque nous sommes toutes et tous uniques.
- 2005 : Politique visant à prévenir et à contrer l’incivilité, la discrimination et le harcèlement
- 2019 : Plan d’action EDI pour le Programme des chaires de recherche du Canada
- 2019 : Politique visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel
- 2020 : Création d’un comité institutionnel en équité, diversité et inclusion
- 2020 : Signature de la Charte Dimensions
- 2021 : Lancement du Prix de reconnaissance en équité, diversité et inclusion à l’UQAR
- 2021: Embauche d’une agente de recherche en équité, diversité et inclusion
- 2021 : Adoption des recommandations de l’Université du Québec en matière de communication inclusive
- 2022 : Lancement de la Communauté de pratique pour l’EDI en recherche à l’UQAR
- 2022 : Embauche d’une ressources dédiée aux affaires autochtones à l’UQAR
- 2022 : Directive relative au choix du prénom, du nom et du genre
- 2022 : Diagnostic en matière d’équité, de diversité et d’inclusion réalisé auprès de la communauté universitaire
- 2023 : Lancement du plan d’action pour l’EDI dans les activités de recherche de l’UQAR
- 2023 : Politique institutionnelle en matière d’équité, de diversité et d’inclusion
- 2024 : Plan d’action institutionnel en matière d’équité, de diversité, d’inclusion et d’accessibilité
- 2024 : Directive sur les mesures de soutien pour les parents aux études
Le comité institutionnel EDI

Au cours de la dernière année, des actions concrètes ont été faites en vue d’inscrire les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) au cœur de la mission de l’UQAR. Nos efforts nous ont menés à créer un comité institutionnel en équité, diversité et inclusion (CIEDI) afin de coordonner la transformation de la culture institutionnelle et de formuler des recommandations aux membres de la direction ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire sur les enjeux en matière d’EDI.
Au-delà de la conformité légale, une véritable inclusion des personnes appartenant aux groupes désignés appelle à un questionnement inéluctable des facteurs d’exclusion en identifiant en amont les sources de discrimination. Il importe dès lors de réfléchir aux pratiques, aux actions et aux préjugés inconscients qui portent préjudice aux personnes afin de se doter de critères objectifs ne conduisant pas à l’exclusion des groupes désignés.
Ensemble, traçons la trajectoire d’une communauté universitaire inclusive et ouverte à la diversité!
Mélanie Gagnon
Vice-rectrice à la planification et aux partenariats et présidente du Comité institutionnel en équité, diversité et inclusion
Le mandat principal du Comité institutionnel en EDI (CIEDI) consiste à élaborer les orientations et à guider les actions qui permettront à la communauté universitaire de vivre et de se développer dans un environnement d’études et de travail sain, inclusif et équitable, exempt de toutes formes de discrimination. Son champ d’action s’étendra à l’ensemble des activités de l’Université (formation, recherche, services à la collectivité) afin d’éliminer les inégalités qui touchent les quatre groupes désignés (GD), à savoir les femmes, les minorités visibles, les peuples autochtones, les personnes ayant un handicap, auxquels s’ajoutent les personnes du groupe LGBTQ+.
En créant un espace de dialogue et de partage ouvert, transparent et respectueux de la diversité favorisant la discussion sur les questions et les enjeux en matière d’EDI, le Comité aura la responsabilité de formuler des avis et des recommandations à la direction de l’Université sur les enjeux d’EDI à travers une liste de tâches pouvant comprendre :
- Recenser les politiques, les pratiques et les processus existants qui ont un impact sur l’EDI;
- Consulter la communauté universitaire (cadres, personnes du corps professoral et personnes chargées de cours, personnel administratif, personnel de soutien, et personnes étudiantes) par divers moyens afin d’identifier les obstacles systémiques qui nuisent à l’inclusion et à l’épanouissement des membres des quatre groupes désignés et LGBTQ+ et les besoins des membres de la communauté en matière d’EDI.
- Colliger les propositions afin d’accroître l’équité, la diversité et l’inclusion dans tous les aspects de la vie universitaire;
- Produire un diagnostic à la lumière de l’analyse des données compilées;
- Élaborer un Plan d’action en matière d’EDI comportant des objectifs clairs, des cibles et des indicateurs mesurables qui permettront d’abattre les obstacles;
- Mobiliser la communauté universitaire en vue d’atteindre les objectifs du Plan d’action;
- Recommander, offrir et appuyer la formation et la sensibilisation aux questions et aux enjeux de l’EDI pour toute la communauté;
- Promouvoir et communiquer les meilleures pratiques, initiatives, succès, etc. en matière d’EDI auprès de l’ensemble des membres de la communauté universitaire à travers une programmation diversifiée (ateliers, conférences, témoignages, capsules vidéo, prix, etc.);
- Procéder à l’évaluation périodique du Plan d’action, entre autres, à la mise à jour du diagnostic, à la priorisation des mesures et à l’identification de nouvelles initiatives.
Le Comité est formé des personnes suivantes, nommées par le Conseil d’administration de l’Université pour une période de deux ans, avec possibilité de renouvellement :

Pietro-Luciano Buono
Je suis doyen de la recherche à l’UQAR depuis 2018 et antérieurement professeur de mathématiques à Ontario Tech University. Mon décanat est responsable de la gestion du programme des Chaires de recherche du Canada (CRC). J’ai notamment pris part à la réflexion et la rédaction du plus récent plan d’action en matière d’EDI pour les CRC approuvé par le programme des CRC en 2019. Je suis le parrain de la Communauté de pratique pour l’EDI en recherche (COPEDI) depuis ses débuts.

Maëlle Desrochers
J’étudie présentement au baccalauréat en travail social. Je suis responsable du Trésor à l’Association modulaire des étudiantes et étudiants en travail social (AMETS) au campus de Lévis. J’ai aussi participé à la création du Comité étudiant EDI sur le campus. J’ai à cœur que chaque personne soit accueillie et se sente à sa place. C’est pourquoi je m’implique en EDI.

Mélanie Gagnon, présidente du CIEDI
Je suis vice-rectrice à la planification et aux partenariats à l’Université du Québec à Rimouski et présidente du Comité institutionnel en équité, diversité et inclusion (CIEDI). Détentrice d’un doctorat en relations industrielles, j’ai été professeure en sciences de la gestion à l’UQAR de 2004 à 2020. J’ai publié différents travaux sur l’équité, à la diversité et à l’inclusion de même que sur les pratiques organisationnelles qui sont mises en place pour les personnes employées les plus vulnérables.

Étienne Michaud
À titre de technicien en travail social, je me dédie à plein temps à l’accueil et à l’accompagnement des étudiantes et étudiants internationaux qui arrivent à Rimouski. Avec ma participation au comité institutionnel en EDI, je souhaite contribuer à solutionner les défis qu’elles et ils rencontrent durant leurs parcours chez nous. Plus largement, je désire poursuivre le travail pour faire de l’UQAR un milieu inclusif où tout le monde a sa place.

Louka Labonté, agente de recherche en équité, diversité et inclusion (EDI)
Mon rôle consiste à soutenir la direction, les différents services de l’Université et le comité institutionnel dans leurs efforts pour l’équité, la diversité et l’inclusion et de renseigner la communauté universitaire sur les services disponibles à l’UQAR ainsi que sur les bonnes pratiques en EDI. Je siège à titre d’observatrice sur le comité institutionnel en EDI.

David Ouellet
Je suis secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante de l’UQAR depuis janvier 2018. Je suis notamment responsable de la gouvernance de l’UQAR, de ses affaires juridiques, de l’application des politiques de prévention de l’incivilité, de la discrimination et du harcèlement et de prévention des violences à caractère sexuel. En tant que vice-recteur, je suis également responsable de l’organisation et du développement des services à la communauté étudiante. Je suis avocat, membre du Barreau du Québec depuis 1998.

Andrée-Anne Parent
Professeure et directrice du module en kinésiologie au département des sciences de la santé, je travaille principalement sur la physiologie de l’exercice sous contraintes extrêmes, un milieu où beaucoup de travail en EDI reste à être réalisé. Dans mon parcours, je tente d’outiller les futures kinésiologues à des pratiques en activité physique plus inclusives et sécuritaires.

Guillaume Perron
Je suis chargé de cours en travail social à l’UQAR depuis 2011. Les valeurs de respect, d’ouverture et d’inclusion ont toujours été très importantes pour moi. Il me fait donc plaisir de veiller à créer et améliorer constamment une politique s’assurant de l’application de ces valeurs auprès de toustes.

Steve Rousseau
Je suis détenteur d’un baccalauréat avec majeure en relations industrielles et mineure en santé et sécurité du travail ainsi que d’un certificat en administration à l’UQAR. J’ai œuvré 28 ans dans la fonction publique, d’abord à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) puis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à titre de directeur des services administratifs dans les régions Est-du-Québec, Côte-Nord et Gaspésie Iles de La Madeleine.

Mouhamadou Sanni Yaya
Administrateur agréé de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec et titulaire de plusieurs titres universitaires dont un doctorat en droit de l’Université de Montréal, je suis professeur à l’UQAR. Je m’intéresse particulièrement aux aspects juridiques du télétravail, de l’économie digitale et de la discrimination à l’emploi.
L’équité, la diversité et l’inclusion en recherche
L’UQAR possède une longue tradition d’excellence en recherche. Année après année, elle se classe parmi les meilleures universités canadiennes de sa catégorie. Inscrite dans l’ADN de sa mission, la recherche doit également s’adapter et se renouveler afin d’encourager et de soutenir l’épanouissement de tous les talents qui forment notre communauté.
Dans cet esprit, l’UQAR pose des gestes structurants dans ce sens afin d’inscrire les valeurs d’EDI dans sa mission de recherche.
Initié par les trois organismes subventionnaires fédéraux (CRSH, CRSNG, IRSC), le programme Dimensions vise à éliminer les obstacles qui touchent notamment les femmes, les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap, les membres de minorités visibles ou de groupes racisés et les membres de la communauté LGBTQ+. Il reconnaît publiquement les établissements qui s’engagent à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion en recherche.
Plus concrètement, « l’objectif du programme est de provoquer une transformation dans l’écosystème de la recherche en invitant les établissements postsecondaires canadiens à repérer et à éliminer les obstacles et les iniquités. Ce faisant, ils assurent un accès équitable aux possibilités de financement, favorisent l’inclusion et la participation équitable dans le milieu de la recherche tout en facilitant l’intégration des principes d’EDI dans la conception des programmes de recherche et les pratiques en recherche ». (Source)
L’UQAR a adhéré à la Charte Dimensions en 2020.
Une consultation de membres du corps professoral et de membres de l’équipe du décanat de la recherche a permis d’identifier des besoins, des problématiques, des points faibles et des solutions à mettre en place en matière d’EDI en recherche. Ces éléments peuvent être regroupés en trois grands objectifs :
- Le développement des connaissances en matière d’EDI
- La carrière professorale et les équipes de recherche
- La conception des projets de recherche
Pour chacun de ces grands objectifs, des actions sont ciblées à courte échéance pour travailler aux constats établis comme prioritaires. Dans une perspective de mise en œuvre séquentielle, les actions à entreprendre seront redéfinies sur une base annuelle.
Exigence du Secrétariat du programme des Chaires de recherche du Canada depuis 2020, chaque université qui dispose de cinq chaires de recherche du Canada ou plus doit élaborer un plan d’action afin de se conformer aux politiques fédérales de non-discrimination et d’équité en matière d’emploi.
Ce plan d’action s’appuie sur un état des lieux et vise à apporter des correctifs aux politiques, aux pratiques et aux processus d’embauche des titulaires de chaires. L’objectif est d’atteindre les cibles de représentativité des membres des groupes désignés (femmes, minorités visibles, Autochtones et personnes handicapées) parmi les titulaires de chaires.
L’UQAR a déposé son Plan d’action en 2019 et travaille actuellement à sa réalisation.
L’UQAR souscrit pleinement aux principes d’équité, de diversité et d’inclusion en matière d’accès à l’emploi, notamment pour les femmes, les personnes handicapées, les Autochtones et les personnes de minorités visibles (les « groupes désignés »). L’UQAR reconnaît que l’équité, la diversité et l’inclusion sont un gage d’excellence en recherche. Dans cet esprit, l’UQAR s’engage à déployer des moyens concrets, inspirés des bonnes pratiques reconnues, pour donner, au sein même de son établissement, des résultats tangibles et significatifs en matière d’équité, de diversité et d’inclusion à l’égard des groupes désignés.
Une stratégie de sensibilisation à l’égard de l’équité, de la diversité et de l’inclusion a été et continuera d’être déployée au sein de l’UQAR, mettant notamment en valeur les avantages qui sont associés à ces principes. Cette stratégie comprend des initiatives visant la formation du personnel et des gestionnaires, la gestion des ressources humaines, la sélection des candidates et des candidats au poste de titulaire de CRC et un mécanisme de reddition de compte visant à assurer la transparence, soit l’actuelle page web, qui sera maintenue à jour. Cette stratégie implique également une mise à jour des connaissances et des meilleures pratiques en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Une formation portant spécifiquement sur les préjugés involontaires, développée par les Instituts de recherche en santé du Canada, est également donnée à toutes les personnes impliquées dans le processus de sélection des titulaires de chaire.
On trouvera, dans le Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion de l’UQAR, d’autres initiatives et activités qui sont ou seront déployées dans le cadre de cette stratégie de sensibilisation.
Dès 2017, l’UQAR s’est dotée d’un plan d’action visant à concrétiser ses intentions relatives au Programme des CRC en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Le Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion a été rédigé par le Bureau du doyen de la recherche de l’UQAR, sous la supervision du vice-recteur à la formation et à la recherche, M. François Deschênes. Le plan d’action a été réalisé à partir des travaux du Comité d’élaboration du plan d’action de l’UQAR en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Ce plan a également été rédigé à partir des recommandations du Programme des chaires de recherche du Canada et des bonnes pratiques reconnues. Le plan d’action a été révisé en décembre 2018 par le Bureau du doyen à la recherche. Après le résultat de l’évaluation du plan d’action 2018, l’UQAR a fait une révision de son plan d’action qui a été soumis au Programme des Chaires de recherche du Canada en septembre 2019. Ce plan d’action se trouve ci-dessous.
L’élaboration et la mise en œuvre de ce plan d’action étaient sous la responsabilité du Vice-rectorat à la formation et à la recherche de l’UQAR. La vice-rectrice à la planification et aux partenariats et présidente du CIEDI sera chargée de mesurer les progrès du présent plan d’action et d’en rendre compte dans une mise à jour annuelle, lors de la reddition de compte prévue par le PCRC.
Mélanie Gagnon, Ph. D.,
Vice-rectrice à la planification et aux partenariats et présidente du Comité institutionnel en EDI
418-833-8800, poste 3333
1 800 463-4712, poste 3333
edi@uqar.ca
Les personnes désirant déposer une plainte concernant le respect à l’UQAR de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans la gestion du processus de sélection des titulaires de Chaires de recherche du Canada peuvent communiquer avec le Secrétariat général et vice-rectorat à la vie étudiante :
David Ouellet
Secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante
418 723-1986, poste 1416
1 800 511-3382, poste 1416
secgen@uqar.ca
Pour être examinée, la plainte devra être pertinemment documentée et s’appuyer sur des faits.
La plainte sera traitée le plus rapidement possible. Si la réponse n’est pas jugée satisfaisante par la personne ayant déposé la plainte, cette personne sera invitée à communiquer avec le Secrétariat général de l’UQAR. La secrétaire générale ou le secrétaire général devra analyser attentivement la plainte et communiquer au besoin avec la plaignante ou le plaignant ainsi qu’avec la présidente ou le président du comité de sélection de la ou du titulaire de chaire. Si la plainte est jugée recevable, la secrétaire générale ou le secrétaire général constituera un comité ad hoc composé d’elle-même ou de lui-même et d’au moins deux autres personnes n’ayant pas été impliquées dans le processus de sélection de la ou du titulaire de chaire. Ce comité d’examen de la plainte devra être composé majoritairement de membres des groupes désignés, et devra inclure au moins un membre du corps professoral de l’UQAR. Le comité déposera ensuite un rapport au Bureau du recteur de l’UQAR pour décision.
À toutes les étapes du processus de plainte, chaque personne devra se conformer aux processus existants dans le cadre de la convention collective des professeures et des professeurs de l’UQAR, et notamment aux mécanismes de griefs.
Les personnes titulaires de chaires qui ont des interrogations ou des préoccupations sur la gestion interne des chaires de recherche du Canada sont invitées à en faire part au Décanat de la recherche qui s’assurera de les examiner et de porter ses conclusions au Vice-rectorat à la formation et à la recherche. Les titulaires peuvent également en discuter, via leur représentant, à la Sous-commission de la recherche de l’UQAR. Des réunions ad hoc des titulaires de CRC sont également organisées au besoin avec le Décanat de la recherche (la dernière s’est tenue le 19 novembre 2019). Autrement, les plaintes peuvent être adressées au Syndicat des professeures et des professeurs de l’UQAR, qui voit à leur suivi selon les procédures habituelles.
Le Programme des CRC a établi des objectifs en matière d’équité. Les mesures à prendre pour combler cet écart sont détaillées dans le Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion de l’UQAR.
|
| Cible fixée par le PCRC pour décembre 2022 | Écart (automne 2022) |
| Femmes | 2 | * |
| Minorités visibles | 1 | * |
| Personnes handicapées | 0 | * |
| Autochtones | 0 | * |
Outil d’établissement des cibles en matière d’équité
*Afin de protéger les renseignements personnels des titulaires de chaire, les nombres inférieurs à cinq et les pourcentages associés ne sont pas divulgués conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
L’embauche des titulaires de CRC est actuellement soumise aux règles de la convention collective du Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Rimouski, le Code du travail du Québec et la Loi sur l’équité en matière d’emploi du Canada.
L’annexe 9 du Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion détaille la gestion interne des CRC à l’UQAR.
Affichages de postes actuels
(Tous ces affichages sont ouverts aux candidates et aux candidats externes)
Aucun affichage pour le moment.
Affichages de postes antérieurs
(Tous ces affichages ont été ouverts aux candidates et aux candidats externes)
- Professeure ou professeur titulaire d’une chaire de recherche du Canada (niveau 2) en transitions territoriales
- Appel de candidatures – Chaires d’excellence en recherche du Canada – Sciences de la mer
- Call for applications: Canada Excellence Research Chairs – Marine Science
*Pour plus d’information concernant l’équité, la diversité et l’inclusion dans le cadre du Programme des CRC, on peut consulter la page qui y est consacrée sur le site du programme : http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/index-fra.aspx.
En 2006, une entente de règlement a été ratifiée entre le PCRC et un groupe de huit universitaires qui avait déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne en 2003. En 2017, à la demande des plaignantes qui estimaient insuffisants les progrès accomplis en matière de sous-représentation de groupes désignés, l’entente de 2006 est devenu une ordonnance de la Cour fédérale. Suite à une médiation entre les parties pour régler les iniquités du Programme d’une manière systémique, structurelle et durable, un addenda signé en 2019 définit maintenant les nouvelles dispositions de l’entente de règlement, suivez ce lien pour plus de détails: Addenda de 2019.
Le Fonds d’urgence pour la continuité de la recherche au Canada est une initiative du gouvernement fédéral dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Ce programme temporaire vise à appuyer financièrement les universités et les établissements de recherche du Canada à absorber les contrecoups de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de la recherche au Canada et ainsi maintenir la compétitivité du Canada dans l’économie du savoir mondiale.
Ce programme interorganisme est administré par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) au nom des trois organismes subventionnaires fédéraux. Le Comité de coordination de la recherche au Canada (CCRC) assure la surveillance stratégique du programme et approuve les subventions. Le Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements est chargé de l’administration.
Le programme vise deux objectifs :
- fournir un soutien salarial aux universités et aux établissements de recherche en santé, qui ne sont pas admissibles à la subvention salariale d’urgence du Canada, afin de les aider à retenir leur personnel de recherche pendant la pandémie de COVID-19 (jusqu’à 325 millions de dollars);
- fournir un soutien pour les coûts supplémentaires extraordinaires associés au maintien d’engagements essentiels en recherche pendant la pandémie de COVID-19 et à la reprise à plein régime des activités de recherche une fois que les mesures de distanciation physique seront assouplies et que les activités de recherche pourront reprendre (125 millions de dollars).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site web du programme : https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/crcef-fucrc/index-fra.aspx.
Processus de décision pour la distribution des fonds à l’étape 1
Conformément à l’engagement des trois organismes subventionnaires en matière d’EDI, l’UQAR est désireuse de promouvoir l’excellence en recherche tout en assurant qu’elle soit inclusive, diversifiée et équitable en endiguant les obstacles systémiques auxquels font face les personnes en quête d’équité, plus fortement touchées en période de crise.
Un haut dirigeant, devant veiller à ce que les exigences du programme soient remplies, a été désigné. Il s’agit de madame Mélanie Gagnon, vice-rectrice à la planification et aux partenariats. Elle est également responsable de l’EDI au plan institutionnel. Un groupe de personnes chargées de prendre les décisions relatives à l’utilisation des fonds a été créé en second lieu, groupe au sein duquel les personnes en quête d’équité sont représentées :
- Mélanie Gagnon, vice-rectrice à la planification et aux partenariats
- Pietro-Luciano Buono, doyen de la recherche
- Madone Lévesque, directrice du Service des finances et approvisionnements
- Youssouf Djibril Soubaneh, professeur
Les membres du groupe ont été sensibilisés aux préjugés inconscients et ont tous suivi le module de formation en ligne des organismes subventionnaires.
Une culture d’EDI en recherche et, plus largement, est au cœur des processus décisionnels de l’Université et est intégrée au plan d’action du plan d’orientation stratégique. Un énoncé de principe en matière d’EDI a été adopté et affirme la volonté d’étendre les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion à toutes les sphères d’activité de l’Université.
Une stratégie visant à maintenir des pratiques exemptes d’obstacles systémiques tout en favorisant la prise en compte des facteurs ayant pu concourir à l’incapacité des personnes à travailler pendant la pandémie a été retenue. La littérature reconnaît par ailleurs que les femmes recourent plus fréquemment que leurs collègues masculins à des méthodes de recherche qualitatives ayant pu être davantage affectées pendant la crise sanitaire (impossibilité de rencontrer les personnes et d’aller sur le terrain pour collecter des données).
Pour la prise de décision relative à la répartition des fonds, il a été demandé aux ressources professorales visées de faire état des différents événements ou situations ayant pu constituer des freins à leur carrière au cours de la période de pandémie.
Sont donc considérés :
- les aléas et le poids des tâches de la vie personnelle et familiale ayant eu des incidences sur la marge de manœuvre nécessaire pour se dégager du temps pour la recherche;
- la méthodologie de recherche dont les protocoles ont été arrêtés durant la crise, reportés ou annulés;
- le caractère possiblement distinctif de la recherche en cours en lien, soit avec des approches disciplinaires atypiques, des modes de connaissance autochtones ou se rapportant à des groupes minoritaires reconnus.
Ces facteurs seront également pris en compte au cours des années à venir dans les différentes étapes de la carrière de manière à éviter de pénaliser les personnes pour qui les impacts de la pandémie auront été plus importants, notamment les personnes en quête d’équité. Les difficultés de conciliation de travail-famille, plus portées par certaines personnes des groupes cibles, ont freiné la production scientifique et leur capacité de recueillir des fonds pour entreprendre des recherches. À cela s’ajoute les collectes de données qui ont été ralenties et qui s’accompagnent de l’impossibilité de publier des articles tributaires de l’avancement de carrière professorale.
Les fonds reçus par l’UQAR ont été utilisés de telle façon à inclure l’ensemble des chercheuses et chercheurs tout en respectant les principes en matière d’EDI.
Mélanie Gagnon Ph. D.,
Vice-rectrice à la planification et aux partenariats et présidente du Comité institutionnel en EDI
UQAR, campus de Lévis
418-833-8800, poste 3333
1 800 463-4712, poste 3333
edi@uqar.ca
Ce guide a été conçu pour accompagner les équipes de recherche dans la création d’un environnement qui favorise l’équité, la diversité, l’inclusion et l’accessibilité.
Des questions sur l’EDIA à l’UQAR?