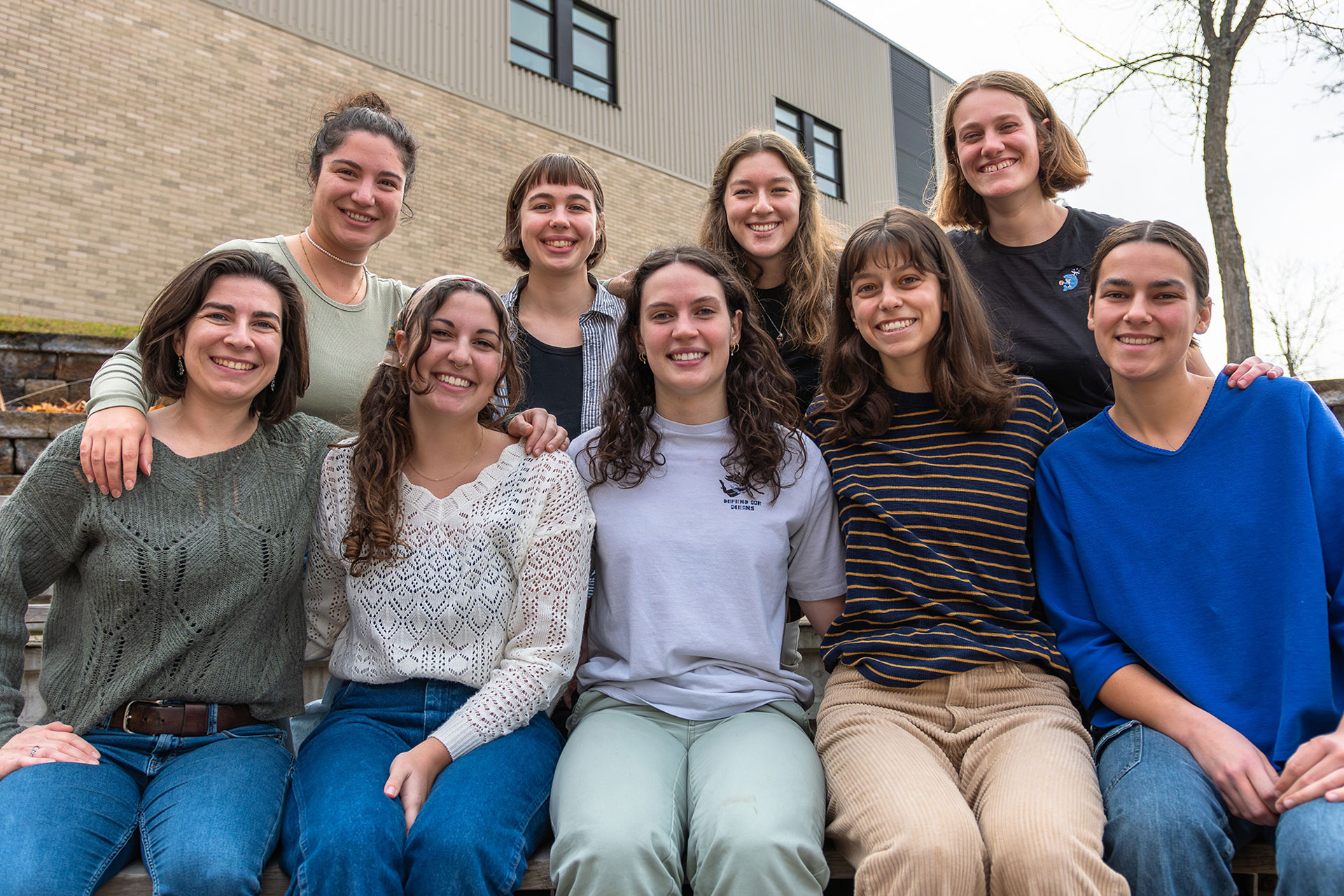Certaines espèces animales vivent des centaines d’années. Une palourde de l’espèce Arctica islandica de 507 ans a d’ailleurs été découverte l’année dernière en Islande. Comment expliquer une telle longévité ? Le doctorant Daniel Munro et le professeur de biologie Pierre Blier ont réussi à en percer l’un des secrets. Une découverte majeure dans le domaine de la physiologie animale.
Daniel Munro se spécialise sur les déterminants physiologiques de la longévité. Par une approche comparative, il étudie les mécanismes physiologiques et biochimiques qui permettent à certaines espèces de vivre beaucoup plus longtemps que d’autres. « Dans cette approche, on ne parle pas de maladie de vieillesse, mais de sénescence qui est la perte graduelle des capacités physiologiques telles le système immunitaire, les capacités musculaires et les capacités cognitives », précise-t-il.
Pour expliquer comment la palourde Arctica islandica peut vivre plus de 500 ans, Daniel Munro a étudié six à neuf individus de cinq espèces de palourdes matures différentes, mais de tailles similaires. Ces palourdes du groupe taxonomique des vénéridés provenaient du Bas-Saint-Laurent (Bic), des Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord (Forestville) et du Nouveau-Brunswick (Neguac). Affichant des longévités maximum de 28 ans, de 37 ans, de 92 ans et de 106 ans, ces palourdes ont été comparées aux Arctica islandica.
Les chercheurs de l’UQAR ont tout d’abord testé la théorie du vieillissement par le stress oxydant, une hypothèse développée à partir des années 1950. « Le stress oxydant est le stress qu’un organisme subit au fur et à mesure que les radicaux libres – une espèce moléculaire dérivée de l’oxygène – attaquent ses composantes cellulaires fondamentales, comme les protéines, les lipides et l’ADN », explique le professeur Blier. « Ces molécules supportent le fonctionnement d’une cellule et l’attaque par les radicaux libres leur fait perdre leur fonction, ce qui cause le vieillissement. »
Dans 95% des cas, ce sont dans les mitochondries – un organite de la cellule responsable de la consommation de l’oxygène – que l’oxygène se transforme en un dérivé moléculaire dangereux. « Les études ont démontré que la quantité d’oxygène consommée par les mitochondries n’explique pas la production de radicaux libres. C’est plutôt la façon dont elles fonctionnent. Ainsi, chez les espèces qui vivent plus longtemps, le fonctionnement des mitochondries permettrait de réduire la production de radicaux libres », souligne Daniel Munro.
Contrairement aux protéines et à l’ADN, l’attaque des lipides par les radicaux libres entraine une réaction en chaîne. Ces lipides forment notamment les membranes cellulaires et les membranes de certains organites au sein de la cellule. « Quand les radicaux libres brisent un lipide, ils produisent à partir de ce lipide une autre espèce réactive de l’oxygène – un dérivé – et les lipides se mettent à réagir entre eux et à libérer plusieurs composés nocifs alors qu’il n’y a qu’un radical libre qui les a attaqués. Il y a une réaction en chaîne et une multiplication des conséquences », précise le professeur Blier.
« Cette oxydation des lipides exacerbe le problème de stress oxydant, un peu comme un amplificateur, ajoute Daniel Munro. On s’est rendu compte qu’il n’y a pas seulement des différences entre les espèces dans le niveau de production des radicaux libres, mais aussi dans la force de leur amplification par les lipides membranaires. Pour poursuivre avec cette analogie, les espèces qui vivent longtemps tentent de minimiser ce facteur d’amplification. Et il est à son plus bas chez l’espèce qui vit 507 ans comparativement aux autres espèces de palourdes. Donc, l’espèce qui vit longtemps diminue à la fois le signal et l’amplificateur du stress oxydant au quotidien. Cela fait en sorte de ralentir le vieillissement. »
Cette recherche sur la longévité des palourdes s’est déroulée sur trois ans. Les chercheurs Pierre Blier et Daniel Munro ont testé la composition lipidique de leurs espèces de palourdes pour démontrer la corrélation avec la longévité de la palourde Arctica islandica. Plus précisément, ils ont analysé les mitochondries présentent dans les branchies des palourdes de même que les autres composantes cellulaires dépourvues de mitochondries. Ces palourdes ont été élevées pendant une période de 6 mois à un an à la Station aquicole de l’UQAR-ISMER.
« Nous les avons mis dans des conditions communes, tant en ce qui a trait à la température, à la salinité qu’à la nutrition. Étant dans des conditions communes, leur compositions lipidiques n’ont pas reflété une acclimatation de la population d’origine dans l’environnement d’origine, qui peut différer d’une population à l’autre au sein de la même espèce », mentionne le doctorant en biologie. « En les mettant dans les mêmes conditions et en limitant le facteur environnement ou nutrition, on s’assure que les différences sont dictées par des processus génétiques propres à l’espèce et qui ont une valeur adaptative. »
Dans les laboratoires de l’Université du Québec à Rimouski, Daniel Munro a analysé les lipides des palourdes. « Nous utilisons un appareil appelé GC-MS qui sépare les différents types de lipides les uns des autres. Il nous donne l’information sur chacun afin de les identifier et de les quantifier. Par la suite, nous pouvons faire un profil qui reflète la proportion de chacun de ces lipides et obtenir ce que l’on nomme un indice de péroxydation. Cet indice nous dit à quel point la membrane est sensible à l’oxydation, donc comment elle va se comporter comme amplificateur de l’activité des radicaux libres », note M. Munro.
Ainsi, plus l’indice de péroxydation est élevé, moins la palourde va vivre longtemps. « L’indice de péroxydation des membranes des mitochondries décroit en suivant une fonction exponentielle négative. Quand on fait notre comparaison au sein du groupe, nous avons cette décroissance de la force de l’amplification du stress oxydant. Le même type de relation entre l’indice de peroxydation et la longévité ont également été observé chez les mammifères– mais dans ce cas les relations sont beaucoup moins claires et convaincantes, entre autre parce qu’il s’agit d’organismes qui vivent dans des conditions très différentes et donc qu’ils se comparent difficilement les uns aux autres», illustre Pierre Blier.
Cette découverte de MM. Blier et Munro a été publiée à l’automne 2012 dans le journal scientifique Aging Cell, la plus importante des publications dans le domaine de la biologie du vieillissement. « C’est passablement rare qu’un étudiant au doctorat publie dans une revue qui a ce niveau de réputation», conclut le professeur Blier, codirecteur de la thèse de doctorat de Daniel Munro avec André Martel, du Musée d’Ottawa.
Pour nous soumettre une nouvelle : communications@uqar.ca