Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS
Le Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS s’intéresse à la diversité et à la conservation des géoécosystèmes nordiques soumis à une longue saison froide qui, s’étendant de la forêt mixte caractéristique de la région de Rimouski aux zones polaires du Grand Nord, dominent la géographie québécoise et canadienne.


Le Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS est voué à l’épanouissement et au rayonnement de la recherche sur les environnements nordiques. Les recherches du Groupe s’inscrivent dans le cadre des problématiques générales des changements globaux, du maintien de la biodiversité et de l’utilisation durable des ressources naturelles. Ce groupe de recherche regroupe une vingtaine de chercheurs, des professionnels et plus d’une centaine d’étudiants qui s’intéressent aux environnements nordiques continentaux et qui les parcourent en tout sens, de Rimouski au Nunavut et de la Gaspésie à la Norvège.
« BORÉAS est dans la mythologie grecque la personnification du vent du nord, celui qui apporte l’hiver, le père de la neige et le compagnon des peuplades nordiques. Il symbolise l’esprit des recherches que nous menons ».
BORÉAS voit à favoriser, stimuler et supporter l’acquisition et le transfert de connaissances scientifiques sur la structure et le fonctionnement des environnements nordiques. BORÉAS soutient également les efforts de recherche et les moyens de mise en oeuvre pour adapter les sociétés situées en milieu nordique aux grands changements environnementaux.
Thème 1: Programmation scientifique
- Objectif 1.1: Faciliter l’acquisition et l’échange de connaissances interdisciplinaires sur la dynamique et le fonctionnement des environnements nordiques.
- Objectif 1.2: Réalisation de synthèses de la connaissance scientifique.
- Objectif 1.3: Développer des outils d’aide à la décision pour répondre aux défis d’adaptation des sociétés aux changements environnementaux.
Thème 2: Formation
- Objectif 2.1: Former des personnes hautement qualifiées ayant la capacité d’analyser et de proposer des solutions à des problèmes complexes liés aux environnements nordiques.
- Objectif 2.2: Favoriser des approches interdisciplinaires dans la formation des PHQ liés à l’analyse et la résolution des problèmes.
Thème 3: Services professionnels
- Objectif 3.1: Favoriser le partage des ressources (matériel et humaines) entre les membres.
- Objectif 3.2: Soutenir les membres dans la recherche de financement, la diffusion des résultats et la promotion de leurs activités.
Thème 4: Communication
- Objectif 4.1: Créer un environnement propice aux échanges interdisciplinaires entre les membres du groupe (et l’extérieur) sur des thématiques en lien avec la recherche scientifique et les enjeux de société.
- Objectif 4.2: Favoriser la diffusion/rayonnement de la recherche sur la nordicité pour favoriser le recrutement d’étudiants et l’éducation du public (non-spécialistes).
- Objectif 4.3: Coordonner les actions nordiques au sein de l’UQAR avec les autres groupes et regroupements de recherche, et être LA référence en nordicité à l’UQAR.


Équipe
Les membres réguliers sont professeurs réguliers à l’UQAR et réalisent l’essentiel de leurs travaux de recherche dans les environnements nordiques.
Biologie
- Arseneault, Dominique
- Berteaux, Dominique
- Bêty, Joël
- Blier, Pierre
- Calosi, Piero
- Cloutier, Richard
- de Lafontaine, Guillaume
- Dufresne, France
- Guillemette, Magella
- Nozais, Christian
- Schneider, Robert
- Sirois, Luc
- St-Laurent, Martin-Hugues
- Vézina, François
Géographie
- Bélanger, Simon
- Bernatchez, Pascal
- Buffin-Bélanger, Thomas
- Didier, David
- Gauthier, Francis
- Marie, Guillaume
- Savard, Manon
Chimie
Kinésiologie
Les chercheurs associés ne sont pas membres de BORÉAS selon les règles du regroupement. Ce sont professeurs associés à l’UQAR ou ce sont des personnes qui collaborent avec BORÉAS et dont les activités de recherche contribuent à l’avancement des connaissances sur les environnements nordique.
- Sébastien Descamps, professeur associé et chercheur à l’Institut Polaire de Norvège (NPI)
- Nicolas Lecomte, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie polaire et boréale (Université de Moncton)
- Nathalie Le François, professeure associée et chercheure scientifique au Biodôme de Montréal – Espaces pour la vie
- Patrick Nantel, biologiste à Parcs Canada
- Nicolas Pichaud, Professeur au département de chimie et biochimie de l’université de Moncton
- Bernard Hétu, professeur en géographie retraité
- Autret, Ronan (Chercheur postdoctoral, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Bandet, Marion (Agente de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Banville, Sophie (Agente de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Béland, Charles (Professionnel de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Bélisle, Mathieu (Professionnel de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Boisson, Antoine (Chercheur postdoctoral en géomorphologie et gestion de la zone côtière au Nunavik)
- Bruyère, Catherine (Professionnelle de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Carignan, Marie-Hélène (Coordonnatrice BORÉAS)
- Caulet, Charles (Chercheur postdoctoral, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières
- Chambu Wani, Marcellin (Professionnel de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Corriveau, Maude (Professionnelle de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Demers, Sylvio (Chargé de projet en géomorphologie et dynamique fluviale
- Desrosiers, Véronique (Auxiliaire de recherche en biologie animale intégrative)
- Drejza, Susan (Agente de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Duchesne, Éliane (Professionnelle de recherche, Chaire de recherche en biodiversité nordique, et assistance coordonnatrice, CEN à l’UQAR)
- Dugas, Sébastien (Professionnel de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Dugas, Steeve (Agent de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Dupont-Leduc, Laurie (Candidate au doctorat, Laboratoire d’aménagement et sylviculture)
- Dupuis, Sébastien (Auxiliaire de recherche en écologie historique)
- Éthier, David (Professionnel de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Fraser, Christian (Agent de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Friesinger, Stéphanie (Professionnelle de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Gosselin, Jacinthe (Professionnelle de recherche, Laboratoire de gestion de la faune terrestre)
- Goudreault, Marc-Olivier (Professionnel de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Hugron, Sandrine (Coordonnatrice scientifique, Centre d’études nordiques à l’UQAR)
- Jobin, Ariane (Professionnelle de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Jolivet, Yvon (Professionnel de recherche en microclimatologie et climatologie appliquées)
- Lacombe, David (Technicien)
- Laliberté, Jacob (Agent de recherche, Laboratoire de géomorphologie et gestion des risques en montagne)
- Lapointe, Patrice (Technicien, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Malcom, Kimberly (Professionnelle de recherche, Laboratoire de gestion de la faune terrestre)
- Marion, Nicholas (Professionnel de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- McKinnon, Renaud (Professionnel de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Moisset, Sophie (Professionnelle de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Olsen, Taylor (Chargé de cours au département de Biologie, Chimie et Géographie)
- Paul-Hus, Catherine (Professionnelle de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Régimbald, Lyette (Auxiliaire de recherche, Laboratoire d’écophysiologie aviaire)
- Rioux, Marie-Jeanne (Agente de recherche, Chaire de recherche en biodiversité nordique)
- Savoie-Ferron, François (Professionnel de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- St-Onge, Sylvain (Professionnel de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Thériault, Véronique (Agente de recherche, Laboratoire d’optique aquatique et de télédétection)
- Touchette, Maud (Professionnelle de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
- Verdun, Julia (Professionnelle de recherche, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières)
La recherche sur les environnements nordiques est largement collaborative par sa nature pluridisciplinaire, ses exigences logistiques et ses contraintes financières qui favorisent le partage des idées et la mise en commun des ressources. Les collaborations se font via la codirection de projets de recherche, l’acquisition de subventions communes, la codirection d’étudiants, le partage d’équipement scientifique et l’échange d’idées lors de retraites, séminaires et colloques. Les collaborations se font à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du groupe BORÉAS.
Le milieu de la recherche est extrêmement dynamique et, à l’heure de la communication instantanée et gratuite à l’échelle de la planète, les membres de BORÉAS établissent, maintiennent ou renforcent nombre de collaborations fructueuses en dehors des centres et réseaux organisés avec de nombreuses collaboratrices et de nombreux collaborateurs. Ces derniers ne sont pas membres de BORÉAS.
Québec
- BAILEY, J. Université Laval. Collabore avec N. Le François.
- BÉLANGER, Louis. Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique Université Laval. . collabore avec D. Berteaux.
- BERGERON, Normand. INRS-ÉTÉ, Québec. Collabore avec T. Buffin-Bélanger.
- BIRON, Pascale. Université de Concordia, Montréal. Collabore avec T. Buffin-Bélanger.
- BOUCHER, Étienne. UQAM, Montréal. Collabore avec T. Buffin-Bélanger.
- BUDDLE, Christopher M., Université McGill. Collabore avec J. Bêty.
- CHABOT, D. Institut Maurice-Lamontagne, Ministère des Pêches et Océans. Collabore avec N. Le François.
- CUMMING, Steven. Université Laval, Chaire de recherche du Canada en analyse quantitative des paysages. Collabore avec M.-H. St-Laurent.
- DE BLOIS, Sylvie Université McGill. Collabore avec D. Berteaux.
- DESCHAMPS, M.H. Université Laval. Collabore avec N. Le François.
- DRAPEAU, Pierre. Université du Québec à Montréal, Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQÀM en aménagement forestier durable. Collaborateur de M.-H. St-Laurent.
- DUSSAULT, Christian. Ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec, Direction de l’expertise sur la faune et ses habitats/professeur-associé Université du Québec à Rimouski. Collabore avec M.-H. St-Laurent.
- DUSSAULT, Claude. Ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec, Direction de l’expertise Énergie-Faune-Forêts-Mines-Territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Collabore avec M.-H. St-Laurent.
- FORTIER, Louis. Collabore avec S. Bélanger dans le projet CASES et le réseau ArcticNet.
- FRENETTE, Jean-Jacques. UQTR. Collabore avec S. Bélanger dans le cadre du projet « Riverscape structure and ecological processes o the St Lawrence ».
- GAUTHIER, Gilles. Université Laval. Collabore avec J. Bêty et D. Berteaux.
- GARNEAU, Michelle. Université du Québec à Montréal, GEOTOP. Collaboratrice de P. Bernartchez au projet DÉCLIQUE : dynamique du carbone associé aux tourbières de la Côte-Nord du Québec.
- JAEGER, Jochen A.G. Concordia University, Departement of Geography, Planning & Environment. Collabore avec M.-H. St-Laurent.
- IMBEAU, Louis. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQÀM en aménagement forestier durable. Collabore avec M.-H. St-Laurent.
- ISABEL, Claude. Responsable du service de la conservation et de l’éducation, Parc national de la Gaspésie. Collabore avec BORÉAS.
- LALONDE, Mélinda. Ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec, Direction de l’expertise Énergie-Faune-Forêts-Mines-Territoire de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Collabore avec M.-H. St-Laurent.
- LAMOUREUX, Jean. Ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec, Direction de l’expertise Faune-Forêts-Territoire du Bas-Saint-Laurent. Collaborateur de M.-H. St-Laurent.
- LARIVÉE, Jacques. Regroupement QuébecOiseaux. Collabore avec D. Berteaux.
- LAROQUE, Marie. UQAM, Montréal. Collabore avec T. Buffin-Bélanger et G. Chaillou sur l’hydrogéochimie et radon.
- MAINGUY, Julien. Ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec, Direction de l’expertise sur la faune et ses habitats. Collabore avec M.-H. St-Laurent.
- MARANGER, R. Université de Montréal. Collabore avec G. Chaillou sur le cycle de l’azote et mesure isotopique.
- PAYETTE, Serge. Université Laval, Centre d’études nordiques. Collabore avec P. Bernartchez au projet DÉCLIQUE : dynamique du carbone associé aux tourbières de la Côte-Nord du Québec.
- PELLETIER, Fanie. Université de Sherbrooke, Chaire de recherche du Canada en démographie évolutive et conservation. Collabore avec M.-H. St-Laurent.
- PÉRIÉ, Catherine. Ministère des Ressources Naturelles du Québec. Collabore avec D. Berteaux.
- SAVAGE, Jade. U. Bishop. Collabore avec BORÉAS.
- SIROIS, Pascal. UQAC. Collabore avec C.Nozais – Perturbations anthropiques et réseaux trophiques
- TREMBLAY, Jean-Éric. Université Laval. Collabore avec S. Bélanger aux projets CASES, Malina, CFL et le réseau ArcticNet. Il co-dirige C. Marchese au doctorant en Sc. de l’environnement.
- VANDENBERG, G.W. Université Laval. Collabore avec N. Le François.
Ailleurs au Canada
- BENFEY, T. Université du Nouveau-Brunswick. Collabore avec N. Le François.
- CLAIR, Tom, Envinonnement Canada, Halifax, , collabore avec S. Bélanger au projet « Land-to-sea carbon export from the northeast watersheds of North America to the Northwest Atlantic Ocean ».
- CREASE, T. University of Guelf. Collabore avec F. Dufresne sur l’évolution du transposon Pokey chez les daphnies polyploïdes.
- EHN, J., University du Manitoba, Winnipeg, CNRS, collabore avec S. Bélanger aux projets CASES et MALINA.
- EWAN, Malik. Gouvernement du Nunavut. Collabore avec D. Berteaux.
- FORTIN, Guillaume. Université de Moncton. Collabore avec B. Hétu – Climat hivernal et dynamique des avalanches dans le sud du Québec.
- FRANKE, Alastair. University of Alberta, collabore avec J. Bêty et D. Berteaux.
- GILCHRIST, Grant. Environnement Canada. Collabore avec J. Bêty et D. Berteaux.
- JOHNSON, Chris. University of Northern British Columbia, Natural Resources and Environmental Studies Institute. Collabore avec M.-H. St-Laurent.
- LEMIEUX. Hélène, University of Edmonton. Collabore avec P. Blier et F. Dufresne sur les propriétés fonctionnelles des mitochondries de daphnies ayant différents génomes mitochondriaux.
- LOVE, Oliver. Université de Windsor. Collabore avec J. Bêty.
- McCANN, Kevin. University of Guelph. Collabore avec F. Dufresne sur l’effet de la diversité génétique sur le fonctionnement des écosystèmes.
- McKINDSEY, Chris. Ministère des Pêches et Océans, Canada. Program for Aquaculture Regulatory Research (PARR). Collabore avec G. Chaillou au projet PARR.
- McINTIRE, Eliot. Pacific Forestry Center, Ressources naturelles Canada/Université Laval, Chaire de recherche du Canada en biologie de la conservation. Collabore avec M.-H. St-Laurent.
- PARLEE, Brenda. University of Alberta, collabore avec D. Berteaux.
- REID, Don. Wildlife Conservation Society (Canada). Collabore avec D. Berteaux et J. Bêty.
- SOOS, Catherine. Wildlife disease specialist/research scientist for Environment Canada, Science and Technology Branch. Collabore avec J. Bêty.
- SZOR, Guillaume. Gouvernement du Nunavut. Collabore avec D. Berteaux.
Afique du Sud
- PERRISSINOTTO, Renzo. University of KwaZulu-Natal, Afrique du Sud. Collabore avec C.Nozais au projet : Structure et fonctionnement trophique des réservoirs subtrophicaux.
- PILLAY, D. University of Cape Town, Afrique du Sud. Collabore avec C.Nozais au projet : Relation biodiversité-fonction en milieu littoral.
Allemagne
- PRETZSCH, Hans. Technical University of Munich. Collabore avec R. Schneider sur plusieurs projets.
Angleterre
- BECKERMAN. A. University of Sheffield. Collabore avec F. Dufresne sur la génomique de l’évitement des prédateurs.
- RICE, Stephen. Loughborough University, Angleterre. Collabore avec T. Buffin-Bélanger.
- RUDD. Murray. University of York, Angleterre. Collabore avec D. Berteaux à une étude sur les questions de recherche les plus importantes pour la conservation de la biodiversité au Canada (coauteur de publication).Analyse les contenus en salicortine et trémulacine de la végétation consommée par les porcs-épics (coauteur de publication).
- SPICER, John. University of Plymouth, Angleterre. Collabore avec P. Calosi
Danemak
- HØYE, Toke Thomas. Aarhus University, Danemark. Collabore avec J. Bêty
Espagne
- BENAVENTE, Javier. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Cádiz, Spain. Collabore avec P. Bernartchez à la codirection d’un projet de doctorat: A Functional Sustainable Approach to Vulnerability of Coastal Ecological and Socio-Economical System to Geohazards: Quebec (Canada), Northern Ireland and Spain Coast.
- COOPER, Andrew J. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Cádiz, Spain. Collabore avec P. Bernartchez à la codirection d’un projet de doctorat: A Functional Sustainable Approach to Vulnerability of Coastal Ecological and Socio-Economical System to Geohazards: Quebec (Canada), Northern Ireland and Spain Coast.
États-Unis
- ARRIGO, K, Stanford University, Californie, USA, collabore avec S. Bélanger à l’écriture d’un chapitre pour un numéro spécial de l’International Ocean Color Coordinating Group (IOCCG) sur la télédétection des régions polaires.
- BALCH, William, Bigelow Laboratory of Marine Science, Main, USA, collabore avec S. Bélanger au projet « Land-to-sea carbon export from the northeast watersheds of North America to the Northwest Atlantic Ocean ».
- COLBOURNE, Joe Shaw John. University of Indiana. Collabore avec F. Dufresne sur l’adaptation aux stresseurs multiples chez Daphnia pulex.
- FROUIN, R., Scripps Institution of Oceanography, San Diego, California, USA, collabore avec S. Bélanger à l’écriture d’un chapitre pour un numéro spécial de l’International Ocean Color Coordinating Group (IOCCG) sur la télédétection des régions polaires.
- HOOKER, Stan, NASA, Maryland, USA, CNRS, collabore avec S. Bélanger au projet MALINA.
- JENOUVRIER, Stéphanie. Woods Hole Oceanographic Institution, E-U. Collabore avec J. Bêty
- LAIDRE, Kristin. University of Washington, États-Unis. Collabore avec D. Berteaux et coauteure du Arctic Biodiversity Assessment commandé par le Conseil de l’Arctique (publication prévue pour 2013).
- LINDROTH. Rick. University of Wisconsin, États-Unis. Collabore avec D. Berteaux à l’analyse les contenus en salicortine et trémulacine de la végétation consommée par les porcs-épics (coauteur de publication).
- REYNOLDS, Rick, Scripps Institution of Oceanography, San Diego, California, USA, collabore avec S. Bélanger à l’écriture d’un chapitre pour un numéro spécial de l’International Ocean Color Coordinating Group (IOCCG) sur la télédétection des régions polaires.
- STAMNES, Knut, Stevens Institute of Technology, New Jersey, USA, collabore avec S. Bélanger à l’écriture d’un chapitre pour un numéro spécial de l’International Ocean Color Coordinating Group (IOCCG) sur la télédétection des régions polaires.
- VANNY, Micheal J. Miami University, États-Unis. Collabore avec C.Nozais sur la stoichiométrie des invertébrés aquatiques
- WANG, Menghua, Center for satellite applications and research de la NOAA, E-U. Collabore avec S. Bélanger à l’écriture d’un chapitre pour un numéro spécial de l’Internationao Ocean Color Coordinating Group (IOCCG) sur la télédétection des régions polaires.
Finlande
- BERNINGER, Frank., University of Helsinki. Collabore avec R. Schneider à la codirection d’étudiants (PhD: S. Baral, Postdoc: V. Goudiaby, U. Vepakomma).
- MÄKELÄ, Annikki., University of Helsinki. Collabore avec R. Schneider au projet: adaptation of a structural-functional tree growth simulator to Canadian forest species.
- FRANCE
- ANSCHUTZ, P. Université de Bordeau I. Collabore avec G. Chaillou sur la biochimie et milieux côtiers.
- ANTOINE, D., CNRS, Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-mer, France, collabore avec S. Bélanger au projet MALINA.
- BABIN, Marcel. Laboratoire d’océanologie de Villefranche, CNRS, France, UMI Takuvik, U. Laval. Collabore avec S. Bélanger et G. Chaillou au projet Malina, avec S. Bélanger au réseau ArcticNet et à la Chaire d’excellence du Canada sur la télédétection de la nouvelle frontière Arctique.
- BERNARD, N. Université de Bretagne Occidentale, France. Collabore avec G. Marie au projet : Valorisation du patrimoine maritime culturel des littoraux finistériens (Bretagne).
- CHARLES, François. Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer, France. Collabore avec C.Nozais au projet: Écologie des invertébrés benthiques.
- DOXARAN, David, CNRS, Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-mer, France, collabore avec S. Bélanger au projet MALINA.
- D’ORTENZIO, F. CNRS, Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-mer, France, collabore avec S. Bélanger au projet MALINA et est membre du comité de thèse de Christian Marchese.
- JORRISEN, F. Université d’Angers. Collabore avec G. Chaillou sur l’écologie des foraminifères benthiques et fossilisables.
- LENORMAND, T. CNRS Montpellier. Collabore avec F. Dufresne sur l’origine de la parthénogenèse et de la polyploïdie chez les artémies.
- MOURET, A. Université d’Angers. Collabore avec G. Chaillou sur la biochimie benthique et cycle de l’azote.
- PERON, F. Université de Bretagne Occidentale, France. Collabore avec G. Marie au projet : Valorisation du patrimoine maritime culturel des littoraux finistériens (Bretagne).
- PIEGAY, Hervé. UMR5600 EVS / ENS Lyon, France. Collabore avec T. Buffin-Bélanger à la codirection d’un doctorat.
- TOLOSSA, I. AIEA Monaco. Collabore avec G. Chaillou sur les isotopes stables et les flux de matière.
Islande
- UNNSTEINSDÓTTIR, Ester Rut. University of Iceland, Islande. Collabore avec D. Berteaux à la coorganisation du colloque International Arctic Fox Conference qui aura lieu en Islande en 2013 puis au Canada en 2017.
Norvège
- DESCAMPS, Sebastien. Norwegian Polar Institute. Collabore avec J. Bêty
- FAUCHALD, Per. Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Arctic Ecology Department, Polar Environmental Center, Tromso, Norvège. Collabore avec D. Berteaux au projet TUNDRA et Collabore avec M.-H. St-Laurent.
- FOSS, A. Akvaplan-Niva, Norvège. Collabore avec N. Le François.
- GUNNARSSON, S. Akvaplan-Niva, Norvège. Collabore avec N. Le François.
- HAMEL, Sandra. University of Tromsø, Norvège. Collabore avec D. Berteaux.
- HAUSNER, Vera. University of Tromsø, Norvège. Collabore avec D. Berteaux.
- IMSLAND, A.K. Akvaplan-Niva, Norvège. Collabore avec N. Le François.
- YOCCOZ, Nigel Gilles. University of Tromsø, Norvège. Collabore avec D. Berteaux à la cosupervision des étudiants Arnaud Tarroux, Élisabeth Tremblay et Sandra Lai lors de leurs stages à Tromø et coauteur de publications.
- THOR, Peter. Norwegian Polar Institute, Norvège. Collabore avec P. Calosi
- TVEITEN, H. Nofima, Norvège. Collabore avec N. Le François.
Russie
- OVSYANIKOV, Nikita. Wrangel Island State Nature reserve, Russie. Collabore avec D. Berteaux sur l’écologie du renard arctique dans le cadre de l’Année polaire internationale. (contributeur à une publication).
Suède
DUPONT, Sam. University of Gothenburg, Suède. Collabore avec P. Calosi
Les collaborations extra-muros sont facilitées par l’appartenance des membres de BORÉAS à plusieurs centres et réseaux. Douze chercheur(e)s de BORÉAS sont membres du Centre d’études nordiques (CEN), un regroupement de recherche interuniversitaire entre l’Université Laval, l’UQAR et le centre Eau, Terre et Environnement de l’INRS. Huit sont membres de Québec-Océan, huit du Centre de la science de la Biodiversité du Québec, et trois du Centre d’étude de la forêt (CEF).
Les membres de BORÉAS sont associés aux centres, réseaux et unités de recherches ci-après:
- ArcticNet
- Centre d’études nordiques (CEN)
- Centre d’étude de la forêt (CEF)
- Chaire de recherche du Canada en conservation des écosystèmes nordiques
- Chaire de recherche du Canada en écologie des écosystèmes continentaux
- Chaire de recherche du Canada en géochimie des hydrogéosystèmes côtiers
- Chaire de recherche en géosciences côtières
- Ouranos
- Québec-Océan
- ISMER
- Rexforet
- Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
- Centre d’étude de la forêt
- Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
- Pêches et Océans Canada
- Fiduciaire canadienne d’études nordiques
- Fonds Société et culture
- Société de gestion des rivières de Gaspé
- Centre de la science de la biodiversité du Québec
Projets de recherche
Les projets de recherche des membres du groupe BOREAS sont disponibles sur leurs pages personnelles.
Chaires et laboratoires
À l’UQAR, trois chaires de recherche et plus d’une dizaine d’équipes-laboratoires se consacrent quotidiennement à l’étude des environnements nordiques.
Les Chaires de recherche visent à atteindre l’excellence dans leur domaine d’expertise, aidant les Canadiens à approfondir leurs connaissances et à renforcer leur compétitivité sur la scène internationale. Une Chaire est habituellement composée d’une équipe de chercheurs, de collaborateurs, de professionnels de recherche et d’étudiants des cycles supérieurs.
Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique
Les recherches menées dans le cadre de la Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique visent à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes nordiques, à obtenir une meilleure connaissance des impacts des activités humaines sur les écosystèmes nordiques, et à proposer des méthodes de développement durable dans les écosystèmes nordiques.
Chaire de recherche en géoscience côtière
La Chaire de recherche en géoscience côtière repose sur l’infrastructure du laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières et a été financée grâce à l’initiative du Gouvernement du Québec dans le cadre de la prévention des principaux risques naturels. Le programme de recherche de la chaire vise ainsi à comprendre la sensibilité des régions côtières froides aux changements environnementaux afin d’appréhender leur évolution future. Les études pluridisciplinaires menées par la chaire visent à développer des modèles et à appuyer des initiatives de gestion intégrée dans une perspective de développement durable de l’environnement maritime.
Chaire de recherche sur la forêt habitée
La Chaire de recherche sur la forêt habitée (CRFH) est une initiative du milieu régional comprenant des organismes du secteur forestier du Bas-Saint-Laurent et le Conseil régional de concertation et de développement (CRCD). La chaire mène des études dans les forêts du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, une région où 37 % de l’économie est directement liée à l’écosystème forestier. La programmation de recherche s’articule en trois axes : a) Le fonctionnement de l’écosystème forestier, b) l’aménagement et la sylviculture et c) la socio-économie forestière. La CRFH collabore avec la Forêt Modèle du Bas-Saint-Laurent et le Consortium pour le Développement Durable de la Forêt gaspésienne au déploiement de l’aménagement écosystémique des forêts sur le territoire.
Aménagement et sylviculture
Chercheur responsable : Robert Schneider.
Biologie animale intégrative
Le laboratoire de biologie animale intégrative s’intéresse aux adaptations physiologiques des espèces animales à leur environnement. Nous étudions entre autres la plasticité du métabolisme énergétique et sa capacité d’ajustement notamment aux changements de température, ainsi que les implications de ces ajustements sur les processus de croissance et de vieillissement des animaux. Notre démarche intégrative implique l’utilisation d’outils moléculaires et biochimiques pour répondre à des questions d’évolution et d’écologie à l’échelle des populations et des espèces. Cette approche permet d’identifier les contraintes physiologiques qui limitent les capacités de colonisation de nouvelles niches ainsi que la tolérance aux perturbations de ces niches.
Chercheur responsable : Pierre Blier.
Dynamique et de gestion intégrée des zones côtières
L’équipe de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières mène des études sur l’évolution et la dynamique des systèmes côtiers à l’échelle récente et historique, couvrant le Quaternaire. Les travaux de cette équipe, qui travaille en collaboration étroite avec la Chaire de recherche en géoscience côtière, visent à développer des modèles et à appuyer des initiatives de gestion intégrée dans une perspective de développement durable. L’approche utilisée est basée sur des collaborations étroites entre les intervenants des différents paliers de gouvernements et les communautés côtières.
Chercheurs responsables : Pascal Bernatchez, Guillaume Marie, Bernard Hétu, David Didier.
Écologie historique et de dendrochronologie
Les étudiants et professionnels en écologie historique et en dendroécologie s’intéressent à la dynamique à long terme des écosystèmes et des paysages forestiers de la forêt tempérée nordique et de la forêt boréale, principalement dans la taïga. L’équipe d’écologie historique et de dendrochronologie cherche à comprendre les effets des changements climatiques, des perturbations naturelles (incendies, épidémies) et des perturbations anthropiques (coupes forestières, colonisation) sur nos forêts. Leurs approches, la dendrochronologie et l’analyse d’archives historiques, fournissent des informations essentielles pour aider à aménager les forêts québécoises.
Chercheur responsable : Dominique Arseneault.
Écologie des communautés
Ce laboratoire abrite la Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique et regroupe les chercheurs Dominique Berteaux et Joël Bêty ainsi que leurs étudiants. Les recherches menées par cette équipe visent à mieux comprendre le fonctionnement des communautés animales et des écosystèmes nordiques.
Chercheurs responsables : Dominique Berteaux, Joël Bêty.
Écologie moléculaire
Chercheure responsable : France Dufresne.
Écophysiologie
Les recherches du laboratoire d’écophysiologie sont à l’interface entre la biologie adaptative, la physiologie et l’écologie. Elles s’inspirent des défis énergétiques que les oiseaux doivent relever pour faire face aux contraintes imposées par leur environnement, particulièrement les environnements froids.
Le laboratoire d’écophysiologie dispose d’une animalerie pour oiseaux avec chambres climatiques ainsi que de volières extérieures. Ces infrastructures nous permettent d’étudier, en conditions contrôlées ou semi-naturelles, plusieurs mécanismes permettant aux oiseaux de s’ajuster aux contraintes énergétiques associées à l’environnement hivernal (e.g. régulation hormonale de la production de chaleur, changements morphologiques et comportementaux, nutrition).
Chercheur responsable : François Vézina.
Géomorphologie et dynamique fluviale
L’équipe du Laboratoire de recherche de géomorphologie et de dynamique fluviale s’intéresse aux composantes et interactions de la dynamique fluviale qui s’organisent à plusieurs échelles spatiales et temporelles. Les travaux de cette équipe portent entre autres, sur les glaces fluviales, la structure des écoulements turbulents, le transport des sédiments et la réponse hydrologique des petits et moyens bassins-versants.
Depuis 2011, le laboratoire dispose d’un chenal expérimental de type EM river 4, située dans le pavillon 350 St-Jean-Baptiste de l’UQAR (porte est). Cette installation permet la modélisation d’un large éventail d’environnements tels que les rivières et leurs plaines inondables, les zones côtières, et les processus des eaux souterraines.
Chercheur responsable : Thomas Buffin-Bélanger.
Gestion de la faune et de ses habitats
Les études réalisées dans ce laboratoire portent entre autres sur le statut des populations, les stratégies de reproduction, l’utilisation du territoire, et sur les patrons de migration des oiseaux arctiques et des grands mammifères.
Limnologie et océanographie
Pour plus d’information, communiquer avec le chercheur responsable.
chercheur responsable : Christian Nozais.
Ornithologie marine
L’équipe de recherche de ce laboratoire s’intéresse à l’écologie, la physiologie et le comportement des oiseaux en général mais particulièrement des oiseaux côtiers. Les pratiques laboratoires de cette équipe comprennent la dissection, le séchage des tissus, les mesures calorimétriques ainsi que l’étude des adaptations anatomiques et physiologiques des oiseaux.
Chercheur responsable : Magella Guillemette.
Optique aquatique et télédétection
Le laboratoire d’optique Aquatique et de Télédétection, AquaTel, a été créé en 2010 à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) dans le but de former des spécialistes capables de développer et d’utiliser les technologies de télédétection et d’optique aquatique pour diagnostiquer la qualité des eaux à la surface de la Terre. Ce diagnostic se fait suivant l’analyse de la couleur de l’eau (analyse spectrale), laquelle dépend des propriétés optiques et des concentrations des constituants. Situé à proximité de la mer, notre laboratoire s’intéresse plus particulièrement aux eaux côtières et océaniques, mais aussi aux rivières qui les alimentent. Le suivi par satellite, ou in situ, des propriétés optiques des eaux nous permet de documenter les impacts des pressions anthropiques et naturelles que subissent les écosystèmes aquatiques.
Chercheur responsable : Simon Bélanger.
Paléontologie et biologie évolutive
Chercheur responsable : Richard Cloutier.
Physiologie évolutive marine
À venir.
Chercheur responsable : Piero Calosi.
Sciences forestières
L’équipe de sciences forestières est associée à la Chaire de Recherche sur la Forêt Habitée (CRFH) et regroupe les chercheurs Dominique Arseneault, Dominique Gravel, Robert Schneider et Luc Siois. Cette équipe, qui s’intéresse à ce qui caractérise les forêts du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, travaille en collaboration étroite avec le Consortium en foresterie Gaspésie-les-îles, un centre affilié avec l’UQAR. Elle compte parmi ses méthodes, la microscopie optique qui sert à réaliser des études anatomiques sur les structures reproductrices et végétatives des arbres.
Chercheurs responsables :Dominique Arseneault, Robert Schneider, Luc Sirois.

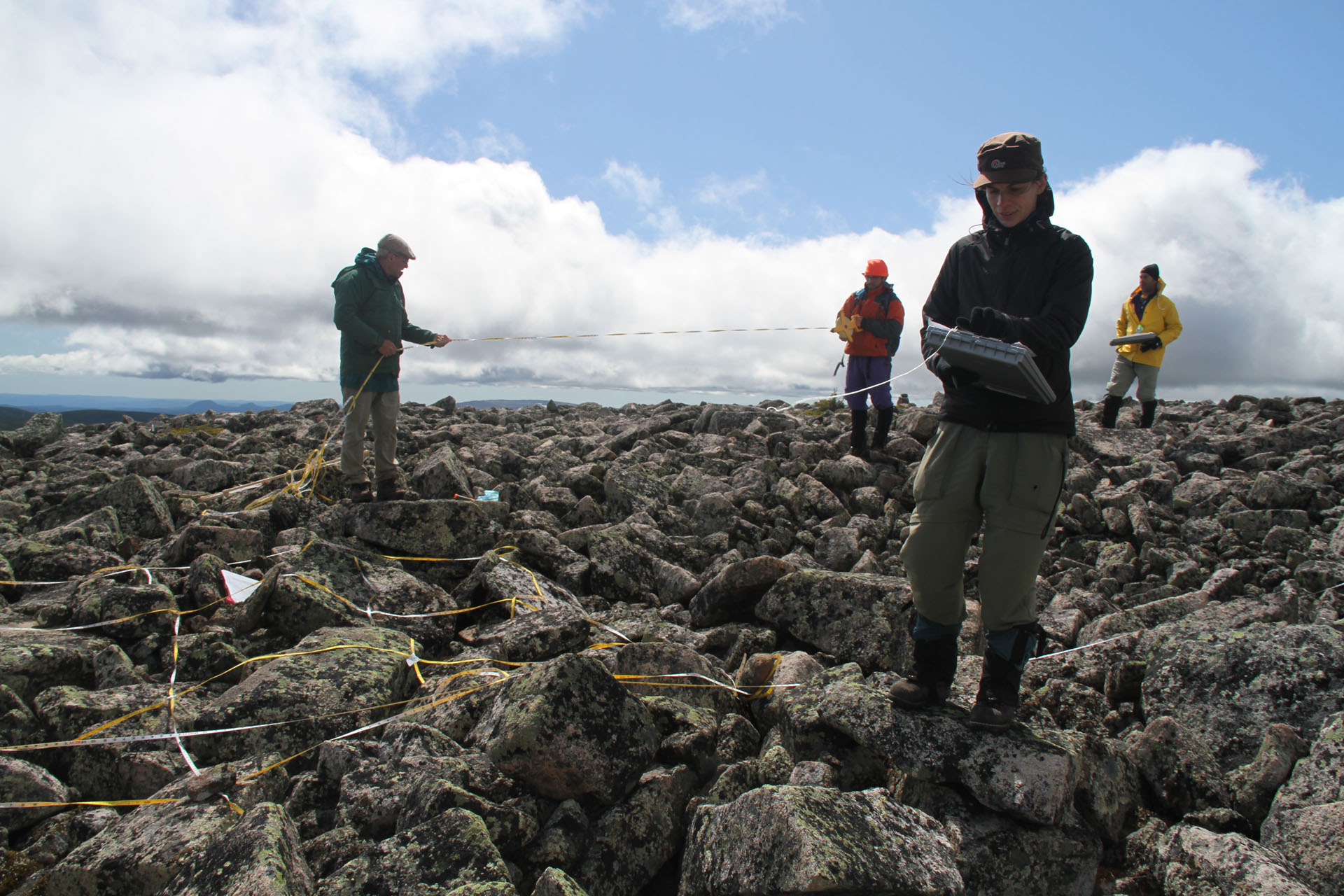
Infrastructures de recherche
Animalerie
L’animalerie de l’UQAR est un atout essentiel qui répond aux impératifs de la recherche et de l’enseignement en biologie. Les étudiants, chercheurs et le personnel de l’animalerie veille aux bons soins et au bien-être des animaux en se conformant lignes directrices et les politiques de Bonnes pratiques animales établies par le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) et aux règlements institutionnels régis par le Comité de protection des animaux (CPA) de l’Université du Québec à Rimouski. Notre animalerie peut héberger jusqu’à une vingtaine de cages ventilées de rongeurs pour la quarantaine et l’hébergement. Elle est composée d’une salle polyvalente et d’une salle humide permettant le maintien de poissons d’aquarium.
Cartothèque
La cartothèque a pour but de répondre aux besoins de l’enseignement universitaire et de la recherche sur le plan de la documentation cartographique. On y trouve des cartes numériques, des photographies aériennes, des atlas, des données numériques et des métadonnées du monde, plus particulièrement du Canada, du Québec et de l’Est-du-Québec. La Cartothèque possède les facilités nécessaires à la consultation des cartes papier et numériques.
Herbier
Pour plus d’information, communiquez avec le chercheur Luc Sirois.
Laboratoire de granulométrie et de sédimentologie
Situé au «Dôme» de l’UQAR (poste ouest), ce laboratoire, disponible pour les besoins de l’enseignement et de la recherche, possède les instruments nécessaires pour étudier la distribution de taille des particules (aussi appelée analyses granulométriques) une des plus importantes caractéristiques du sol. L’intégration de données granulométriques offre une définition quantitative des caractères fondamentaux des sols: la composition, la texture, la conductivité capillaire du sol, le tassement ainsi que la disponibilité en nutriments pour la flore et la faune. L’UQAR possède les infrastructures pour réaliser des analyses granulométriques par tamisage, par décantation et par diffraction laser.
Musée d’histoire naturelle
Pour plus d’information, communiquez avec le chercheur Luc Sirois.
Serre
La petite serre de l’UQAR est principalement utilisée pour la culture de semis d’espèces arborescentes qui constituent d’une part du matériel expérimental pour les cours de physiologie végétale et d’autre part pour la production de semis qui sont transférés dans une pépinière de production, elle aussi située sur le campus. Cette pépinière est une composante importante des efforts de l’UQAR pour compenser les émissions de gaz à effets de serre qui sont produits dans le cadre de ses activités de formation et de recherche.
Volière extérieure et animalerie pour oiseaux
L’UQAR s’est récemment dotée d’une volière extérieure et d’une animalement pour oiseaux avec chambres climatiques. Sous la responsabilité du laboratoire d’écophysiologie, ces infrastructures nous permettent d’étudier, en conditions contrôlées ou semi-naturelles, plusieurs mécanismes permettant aux oiseaux de s’ajuster aux contraintes énergétiques associées à l’environnement (e.g. régulation hormonale de la production de chaleur, changements morphologiques et comportementaux, nutrition). Ces infrastructures nous permettent également d’étudier la capacité des oiseaux à s’acclimater aux perturbations climatiques résultant du réchauffement global. En utilisant des modèles domestiques se reproduisant en captivité, nous pouvons également étudier les effets intersaisonniers issus de contraintes spécifiques (e.g. effet de l’environnement froid sur le succès de reproduction ultérieur).
Le Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS et le Centre d’études nordiques (CEN) partagent et gèrent de nombreuses infrastructures qui facilitent la logistique qu’implique la recherche en milieu froid et/ou nordique. Ces infrastructures comprennent des maisons-dortoirs, des salles de cours, des sites de campements, des laboratoires de travail, des réseaux télémétriques, des véhicules et embarcations nautiques ainsi que des équipements de recherche.
Forêt d’enseignement et de recherche Macpès
Utilisé par l’UQAR et administré par le Cégep de Rimouski, le Pavillon de la Forêt d’enseignement et de recherche (FER) Macpès est accessible à l’année et peut accueillir jusqu’à 60 personnes. Le pavillon comprend une salle de cours, un laboratoire et une salle polyvalente.
Le Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS y a installé un laboratoire mobile pour étudier l’écologie hivernale et l’acclimatation physiologique des oiseaux non migrateurs (mésanges, passereaux) vivant en milieux nordiques.
Station de recherche écologique de Radisson
Située au coeur de la municipalité de Radisson, cette station de recherche du Centre d’études nordiques comprend 3 maisons mises à la disposition des chercheurs du Centre d’études nordiques (CEN) de l’INRS-ETE, de l’Université Laval et de l’Université du Québec à Rimouski.
Située dans la région de la baie James, la station est accessible par la route ou par des vols commerciaux. Elle comprend un laboratoire, un garage et peut accueillir jusqu’à 20 chercheurs simultanément. Des véhicules, des bateaux et un service d’hélicoptère facilitent l’accès à cette vaste étendue de lacs, de terres humides, de forêt boréale, et de réservoirs hydroélectriques. D’ailleurs, plusieurs stations climatologiques du réseau SILA du CEN sont opératinonelles à l’année dans la région. La station est accessible à l’année.
Partenaire du CEN, le Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS y mène les projets suivants: dynamique des forêts à la limite entre les zones boréale et subarctique en lien avec les perturbations naturelles et les changements climatiques; écologie des conifères boréaux; analyses dendrochronologiques des variations hydro-climatologiques; dynamique récente des tourbières.
Réseau CEN Quajisarvik
Le réseau Quajisarvik met à la disposition des chercheurs membres (et non-membres) du Centre d’études nordiques (CEN), huit bases de recherche actives étalées sur près de 3500 km entre Radisson (Baie James) et l’île Ward Hunt.
En 2011 s’est ajouté le Centre communautaire de Whapmagoostui-Kuujjuarapik, le centre de recherche sur le pergélisol de Salluit ainsi le navire de recherche Louis-Edmond Hamelin.
Principalement consacrées à la recherche universitaire, ces infrastructures sont gérées en collaboration ou en partenariat avec les groupes et communautés autochtones vivant sur les lieux. Seules les deux stations de l’extrême Nord sont localisées dans des parcs nationaux et leur gestion est effectuée avec la collaboration de Parc Canada.
Réseau INTERACT
Depuis 2009, le réseau Quajisarvik s’intègre et complète le réseau circumpolaire de stations de recherche terrestres INTERACT et SAON (Sustaining Arctic Observing Networks – arcticobserving.org). Cette nouvelle collaboration avec les utilisateurs et gestionnaires du réseau augmente la visibilité et l’impact scientifique des membres du CEN et de l’UQAR au plan international.
En plus de faciliter l’accès aux chercheurs et étudiants à 79 stations de recherche partagées, ces collaborations facilitent les échanges de données réelles terrains essentiels à la modélisation des changements environnementaux du Nord.
Pour plus d’information, communiquez avec Marie-José Naud, coordonnatrice du Centre d’études nordiques à l’UQAR.
Stations climatiques de Macpès
Depuis 2004, la Forêt d’enseignement et de recherche (FER) de Macpès compte sur un réseau de stations climatiques et hydriques apte à supporter la recherche scientifique dans les domaines de l’écologie et de l’aménagement. Les stations, composées d’équipements hydrologiques et météorologiques sophistiqués, sont situées dans trois sous-bassins de la rivière Rimouski. Les paramètres mesurés permettent d’évaluer l’impact à long terme du changement climatique et des perturbations forestières (aménagements sylvicoles, chablis, etc.) sur le régime hydrique et sur le cycle des éléments nutritifs.
Réseau SILA du CEN
Le réseau SILA de télémétrie instrumentale du CEN est un réseau d’observatoires permanents des changements climatiques et de l’environnement nordique réparti dans huit zones bioclimatiques du Québec. Certaines de ces données sont accessibles en ligne auprès des municipalités hôtes.
SILA signifie, selon la cosmologie ancienne inuit, air universel qui entre et sort de tous les êtres vivants. SILA est également un préfixe utilisé par les Inuits pour qualifier tout ce qui se rattache à l’environnement atmosphérique et universel (météorologie, précipitation, baromètre, univers, climat, astronomie, pression barométrique).
Pour plus d’information, communiquez avec Centre d’études nordiques, coordonnatrice du Centre d’études nordiques à l’UQAR.
Projets d’études
Les projets d’études concernent la recherche en milieu nordique et visent à soutenir les démarches de formation en recherche des étudiants inscrits ou qui souhaitent s’inscrire à temps complet dans les programmes suivants, liés à l’axe d’excellence en recherche en nordicité de l’UQAR :
- maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats;
- maîtrise en géographie;
- doctorat en biologie;
- doctorat en sciences de l’environnement.
Projets en recrutement
Aucun projet présentement.
Publications et communications
Les publications et communications des membres du groupe BOREAS sont disponibles sur leurs pages personnelles.
Vidéos
Le 8 avril 2021, BORÉAS a fièrement accueilli Brigitte Carrier, chargée de cours spécialisée en littérature jeunesse à l’Université Laval et à l’UQAR, ainsi que Jacques Pasquet, écrivain-conteur émérite de l’univers nordique, pour un atelier-conférence sur la nordicité dans la littérature jeunesse. La conférence offre une réflexion sur ce qui distingue les œuvres qui abordent des thèmes nordiques en prenant exemple notamment sur l’album Mon île blessée, écrit par Jacques Pasquet et illustré par Marion Arbona. (2 heures)
Le 24 novembre 2020, George Tombs, artiste de cœur et historien de formation, a présenté une conférence en ligne à propos de sa production The Blinding Sea. Visionnez ici sa conférence au sujet de la réalisation et les réactions à son film reconnu à l’international, où il aborde plusieurs aspects de l’exploration polaire et la relation interculturelle entre les européens/américains euro-descendants et les inuits. (1 heure 10 minutes)
Le 17 novembre 2020, Marianne Falardeau-Côté, communicatrice scientifique et chercheuse postdoctorale à l’Université Laval, invitée par BORÉAS, donne ses conseils pour utiliser les médias sociaux pour diffuser les résultats de sa recherche (60 minutes).
Le 29 septembre 2020, sur l’invitation de BORÉAS, Julie Rocheleau, illustratrice et dessinatrice de bandes dessinées, a démontré l’intérêt d’utiliser les arts visuels, en particulier l’illustration et la bande dessinée pour partager les résultats de la recherche scientifique auprès d’un plus large public (40 minutes).
Le 13 octobre 2020, BORÉAS a invité Catherine-Alexandra Gagnon, présidente du cabinet-conseil Erebia, à présenter les meilleures pratiques et méthodologies en matière de recherche en milieux autochtones dans une optique de réconciliation et de compréhension interculturelle (2 h).








